Révolutionnaires
Récits pour une approche féministe de l’engagement
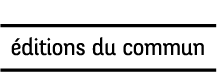

Les Éditions du commun reçoivent le soutien financier
de Rennes Métropole et de la Région Bretagne.
Illustration de couverture : Lucie David
Maquette couverture : Marine Ruault
Maquette intérieure : Marine Ruault
Illustrations : cixy
Relecture : Juliette Rousseau, Marie Afonso et Sylvain Bertrand
Éditions du commun – Rennes
www.editionsducommun.org
Cette œuvre est sous licence Creative Commons :
Attribution – Pas d’utilisation commerciale – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International.
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Éditions du commun © février 2022
Atelier des passages © février 2022
ISBN : 979-10-95630-49-4
Dépôt légal : février 2022


table des matières
Atelier des passages
Révolutionnaires
Des rencontres par l’intime
Féministes et révolutionnaires ?
Approcher à tâtons l’idée de révolution
Ce qui nous inspire
Comment s’articulent fidélités et ruptures idéologiques ? Nous voulons entendre raconter les doutes, les douleurs, les revirements. Fouiller la contradiction et la déception. Chercher le courage et les chocs de compréhension. Soupeser le poids du hasard, des émotions, des contraintes du quotidien. Parce que ces histoires nous livrent d’autres subtilités que celles des théories révolutionnaires écrites par quelques hommes trop contents d’eux-mêmes.
La mémoire de notre histoire(s)
Comprendre que nous ne
comprenons pas
Comment penser nos organisations militantes aujourd’hui ? Comment nourrir les désirs politiques tout en refusant de défendre un programme ? Entre individualisme et collectivisme, anti-autoritarisme et crainte de reproduire dans l’informel et l’affinitaire les hiérarchies habituelles, se reformule, encore et encore, le même enjeu. Celui de gagner en force collectivement tout en favorisant des trajectoires d’émancipation forcément singulières. Interviewées et intervieweu·se·s, nous sommes animé·e·s par cette même aspiration. Mais les discussions s’étirent sans cerner là où nos réponses divergent, et là où les questions restent ouvertes.
La fabrication de nos filiations,
un processus réciproque
Ce n’est qu’un début

Devenir plus invisible ?
Andrea, Montevideo / Uruguay
J’ai embrassé la lutte avec passion
La fin de ma vie légale
Une longue nuit
Je me sentais attirée par les idées anar, les idées libertaires, une manière de penser l’autonomie politique. Alors je reste seule des années, avec ces idées et cette sensation de retenue, de perte.
Il n’y a pas lieu de faire un deuil
Ils n’ont pas retourné leur veste
en un jour
Et il est difficile de penser que si autant de politicien·ne·s ont retourné leur veste, iels l’auraient fait en un jour.
Comment parler de tout ça sans
se vautrer dedans ?
Nous entrons à nouveau dans la nuit
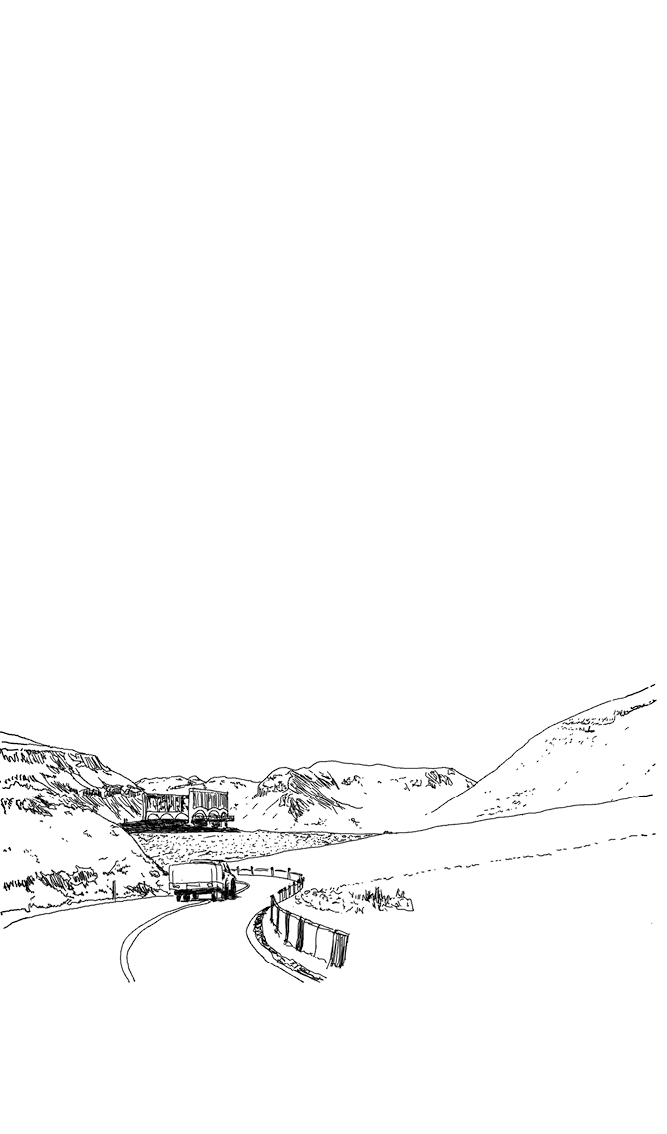
Un enjeu de la lutte des classes
Camille, Dijon / France
Se faire embaucher pour mener
un travail politique
Nous ne séparions pas la lutte et la vie
Contrairement aux revendications réformistes, notre perspective était clairement révolutionnaire, visant la destruction des classes dominantes… Au bout de deux mois, je me suis fait exclure de la CGT parce que j’étais une gauchiste. Ce terme regroupait à leurs yeux l’ensemble des militant·e·s trotskystes, maoïstes, anarchistes, souvent jeunes, assimilé·e·s au mouvement de 68, étudiant·e·s et issu·e·s de la bourgeoisie (ce qui était à moitié vrai, à moitié faux) et qui se disaient communistes sans adhérer au PC ni au modèle stalinien encore en vigueur. Restait donc la CFDT, qui à l’époque était elle aussi minoritaire mais autogestionnaire, non-corporatiste, sur des bases politiques anti-capitalistes et anti-impérialistes. Un syndicat tout à fait fréquentable… Il a bien changé dans les années 80 avec l’accession au pouvoir de la gauche. Mais en 1974, il n’était pas encore réformiste.
mis en place depuis 45 à la Sécu, avec beaucoup de permanences syndicales, c’est-à-dire la possibilité de faire du syndicalisme sur le temps de travail rémunéré. Mais quand je sortais du boulot, je poursuivais mon militantisme avec mon organisation politique, les soirs et les week-ends. Nous ne séparions pas la lutte et la vie, nous étions tout le temps en lutte.
Entre écroulement des perspectives révolutionnaires et survie
de prestations diverses des Caf, de décisions sur les taux de prise en charge, les règles de calcul, etc. ont progressivement été recadrées par l’État. C’était la période où il n’y avait soi-disant plus de fric, où les gouvernants nous bassinaient sur les économies à faire. Ils enfumaient les gens avec cette histoire de « trou de la Sécu », notamment avec le lobby des assureurs, AXA et compagnie, qui n’attendaient que ça pour se faire du pognon. Nous n’étions plus dans la période du plein emploi et la génération très nombreuse du baby-boom était en passe de devenir le papy-boom. La Sécu s’appuyait à la base sur ce déséquilibre démographique, avec un plus grand nombre d’acti·ve·s pour financer les retraites. Sans même prendre en compte l’augmentation du chômage ou les exigences de santé plus grandes, le vieillissement de la population nécessitait forcément de revoir le système de financement. Mais l’augmentation des cotisations, de l’âge de la retraite ou la réduction des remboursements n’étaient pas des bonnes solutions. On aurait pu supprimer les exonérations de cotisations aux entreprises, trouver d’autres financements, conserver cette idéologie de partage… Le « trou de la Sécu » était un discours de culpabilisation, pour préparer la baisse des prestations, le démantèlement de la solidarité.
Continuités et grands écarts
ces personnes s’impliquent à la fois plus totalement, dans un changement de vie maintenant, dans une communisation maintenant. Et à la fois, elles s’impliquent moins, comme si leurs engagements étaient moins fidèles, moins durables, plus individualistes… Il est difficile de savoir de qui on parle quand on dit « nous ». Est-ce qu’on veut être inclusi·ve·s, parler avec et pour plein de monde, à la place de plein de monde ? Est-ce qu’on veut être à des échelles affinitaires, en cercles plus fermés, se distinguer d’autres qu’on ne veut pas rencontrer, avec qui on ne veut pas s’organiser et lutter ? Ces groupes que je fréquente, qui occupent des terrains et des maisons vides, qui font des jardins et des repas de quartiers dans la ville, qui se mobilisent contre les frontières et sur plein d’autres fronts, j’ai l’impression qu’ils sont composés de personnes très différentes les unes des autres… et en même temps, on ne se rencontre pas tant que ça.
[1] Je n’ai pas la mémoire complètement exacte des attaques successives, mais si je devais décrire ça un peu dans les grandes lignes, je dirais que les orientations communistes de la Sécu ont été sapées dès sa création après-guerre. Le premier principe à sauter : « l’universalité » du système, c’est-à-dire le fait que ce soit le même pour tou·te·s, quelle que soit la catégorie professionnelle. Les secteurs ou entreprises ayant déjà leur propre caisse ne voulaient pas passer au régime général de la Sécu, rechignaient à abandonner leurs acquis, et le contrôle direct qu’elles avaient sur leurs organisations, liées à l’histoire des mutuelles ouvrières… Ce qui signifiait de ne pas envisager une solidarité avec l’ensemble de la population. Les personnes qui mettaient en place la Sécu ont lâché assez vite, partant de l’idée que l’intégration se ferait plus tard, de manière progressive…
Ce qui ne s’est pas vraiment réalisé. Ça a donné ce qu’on appelle les régimes spéciaux.
Ensuite, ce sont les règles de gestion qui ont été attaquées. Les ordonnances de 67 imposèrent l’obligation d’équilibre financier au sein de chacune des trois branches et surtout, le strict paritarisme dans les conseils d’administration, réduisant à 50 % la représentation des assuré·e·s sociaux et ramenant à égalité celle du patronat. C’était la fin de la gestion paritaire, c’est-à-dire de la représentation majoritaire des travailleu·se·s, premi·ère·s concerné·e·s. Cette mesure permettait au patronat de prendre le contrôle sur toutes les décisions de montants et de calculs.
Au fil des années, l’État multiplia ses attaques. Et afin de réduire la place des organisations syndicales des salarié·e·s et de leur projet initial, communiste et révolutionnaire, il introduisit au sein des conseils d'administration (CA) des représentant·e·s de la Mutualité française (fédération des principales mutuelles de santé et de protection sociale), des associations familiales, des associations de malades et de personnes qualifiées. Une partie de ces voix étaient « à gauche » mais leurs perspectives réformistes, sociales démocrates, ne faisaient plus barrage aux positions patronales, aux orientations de droite. Et surtout, elles remettaient en cause la représentativité des cotisant·e·s. Cette tendance était encore renforcée par le jeu trouble du syndicat FO, qui prenait systématiquement position en faveur du patronat, en échange de postes de direction pour ses membres au sein des entreprises.
En 1996, la réforme du plan Juppé accrut le rôle du Parlement et instaura les lois de financement de la Sécurité sociale dans lesquelles se trouvent intégrés les objectifs nationaux de dépenses de l’assurance maladie. La loi Douste-Blazy en 2004 installa au sein de l’assurance maladie des conseils, réduisant le pouvoir des CA à l’orientation et au contrôle, et donnant les pleins pouvoirs aux directeurs sur la gestion. La loi HPST de 2009 instaura un encadrement encore plus strict de l’assurance maladie et mit en œuvre les Agences régionales de santé, bras armés du gouvernement en région… Aujourd’hui toutes les décisions des caisses de Sécurité sociale sont soumises de fait à l’approbation des différents ministères des finances, du budget, de la santé et du travail. Un encadrement strict par l’État.

C’était vraiment fou, et cette folie était de loin le meilleur
Herma, Ulenkrug / Allemagne
Naître et grandir en RDA
Je changeais de boulot tous les trois ans
C’était vraiment fou, et cette folie était
de loin le meilleur
est constitué d’une dizaine de coopératives agricoles, dans cinq pays différents, plus de deux cents personnes qui y vivent sur une base anticapitaliste et autogestionnaire.
Il nous faut des discussions
et de la légèreté
[1] Klaus Theweleit : théoricien de la culture et écrivain. Son étude en deux volumes Männerphantasien (Les phantasmes des mâles) s’inscrit dans l’analyse du national-socialisme et est considérée comme l’une des premières recherches sur la masculinité. Dans son livre, fortement inspiré par la psychanalyse ainsi que par Deleuze et Guattari, il examine la conscience fasciste et l’empreinte militaire du moi.
[2] Unidad Popular (UP) : alliance électorale des partis de gauche chiliens, fondée le 17 décembre 1969. Aux élections du 4 septembre 1970, l’UP récolta 36,3 % des voix, ce qui en fit la première force du pays. Son candidat, Salvador Allende, devint président. Aux élections locales suivantes, l’UP obtint 49,7 % des voix. Le gouvernement Allende fut renversé lors du coup d’État militaire du 11 septembre 1973, sous la direction du général Augusto Pinochet, soutenu par les services secrets américains.
[3] Treuhandanstalt : organisme en charge de la privatisation des biens de la RDA, créé dans les derniers jours du régime en 1990, et ayant pour mission de rendre « commercialisables », les usines et l’ensemble des biens auparavant collectivisés de la RDA, par le biais de réorganisations, de privatisations ou de fermetures. C’était le « symbole d’un capitalisme brutal et débridé », selon Iris Gleicke.
[4] Zorba le grec : film de 1964, de Michael Cacoyannis, d’après le roman de Nikos Kazantzakis.

Un peu de culot
Anne-Catherine, Lavaux / Suisse
Quand on fait de la politique,
il faut se montrer solide
À cette époque, nous savions que nous étions surveillé·e·s mais il n’y avait pas de réel danger… Nous nous sentions dans notre droit, ou, en tout cas, non-coupables. Lorsqu’on s’engage vraiment, un des prix qu’il faut payer, c’est cette obligation à cacher ses faiblesses. Un mouvement étudiant, pour moi, à l’époque, ce n’était pas de la « vraie » politique, comme l’implication dans un parti, ce n’était pas un combat dans ou contre des institutions. C’est aussi pour ça que j’utilise le mot culot plutôt que courage, parce qu’il évoque l’innocence, l’insouciance qui nous animait, qui nous donnait l’élan d’y aller. J’étais donc toute enthousiaste d’aider une personne importante du FLN… et au moment de l’indépendance, je croyais que ce grand militant rejoindrait rapidement l’Algérie. Mais il est resté en Suisse et j’ai réalisé qu’il attendait sans doute qu’on l’appelle pour un poste de ministre… Ça m’a profondément déçue et ça a participé à ma prise de distance : pour moi, l’engagement, c’est encore autre chose, il y a celleux qui parlent et celleux qui font. L’Algérie m’a d’une certaine manière appris les réalités de la politique, autant par la guerre de libération que par les convulsions, les bassesses et les lâchetés qui ont suivi son indépendance. J’ai rencontré plusieurs fois des personnalités bien connues de cette histoire, mais les Algériennes et les Algériens qui sont devenu·e·s nos ami·e·s n’étaient pas des héro·ïne·s.
Nous étions nourri·e·s par cette idée
de révolution
peut-être pour échapper au doute, peut-être pour n’avoir pas à négocier les compromis qu’impliquaient les positions réformistes. Nous avons rempli notre premier bulletin d’adhésion et pour moi, ça, c’était réellement le début de l’engagement. Nous avons été invité·e·s à une réunion du secteur Lausanne-nord… et vraiment surpris·e·s qu’on ne nous demande rien en termes politiques. Je pensais que nous devrions nous expliquer sur nos convictions, nos valeurs, mais rien. Le manque total de solennité lors de notre arrivée, l’absence de curiosité des ancien·ne·s concernant nos motivations, le peu d’empressement à nous informer des campagnes et des combats en cours, tout ça nous a pas mal désarçonné·e·s. Le seul rituel consistait à donner du « camarade » à tout le monde… Avec mon mari, nous avons rapidement généralisé cet usage, pour tous les objets de notre vie quotidienne, le camarade réveille-matin, la camarade cafetière, la camarade chatte, le bien-aimé camarade mari… Il y a des mots qui deviennent des signes de ralliement. Lors de mon passage chez les Verts, des années plus tard, le mot « durable » s’est substitué au mot « camarade » avec la même force emblématique. Mais jamais personne en signant une adhésion au POP, ne s’est senti·e obligé·e de brandir le Manifeste du parti communiste. On n’entre pas en politique comme en religion, non, vraiment pas du tout.
Mon père était tellement navré qu’il répétait en boucle « Anne-Catherine Savary au POP… » et ma mère le consolait « Mais elle ne s’appelle plus Savary voyons, elle s’appelle Menétrey maintenant qu’elle est mariée. – Ah oui… ».
C’était une de nos grandes limites, notamment sur la question des femmes. Au fond, ça nous arrangeait bien que la révolution ne soit pas tout à fait pour demain, nous n’étions pas prêt·e·s, nous n’aurions pas su quoi faire et beaucoup de dirigeant·e·s non plus.
Le retour aux lisières du système
L’Histoire ne va nulle part, seul notre présent prépare notre futur
de même que les écrits de Michel Foucault ou de Louis Althusser, et surtout d’André Gorz nous incitaient à porter notre attention vers les margin·ale·s, les prisonni·ère·s et tou·te·s les exclu·e·s. Femmes discriminées sur le marché du travail, jeunes sans emplois à leur sortie de formation, saisonni·ère·s sans droits, chômeu·se·s disqualifié·e·s… Se battre pour ces marges-là, c’était se battre pour l’émancipation de la population tout entière. L’idée d’aller vers une politisation du quotidien, proche des gens, faite d’actions décentralisées, mouvantes, multiples et dispersées, correspondait à ce que j’avais tenté d’exprimer pendant de nombreuses années chez mes camarades du Parti suisse du travail. « Vivre autrement », « réhabiliter le bonheur », étaient pour nous des slogans incarnant de véritables renversements de pensée et de perspective. Nous avions été la génération du militantisme sacrificiel, préparant dans l’austérité des lendemains radieux. Il s’agissait maintenant de mener une vie conforme à nos valeurs, en avançant avec tout ce qui fait la vie, sans compartimenter : l’action, l’émotion, les relations affectives, le travail, les enfants, la cuisine et le jardin. Il y avait là de l’utopie, de la liberté, de la joie, de la naïveté, de l’optimisme et un refus de croire plus longtemps à une finalité de l’histoire : l’Histoire n’allait nulle part, seul notre présent préparait notre futur.
L’appropriation intime des motifs
de la lutte
Dès les années 60, les conditions de vie et d’enfermement dans les asiles ainsi que les traitements imposés aux personnes considérées comme folles avaient été dénoncées, dans de nombreux pays. Ça avait donné lieu à des évolutions plus ou moins conséquentes : organisations pour la défense des patient·e·s, adoucissement et abandon de certaines méthodes, fermeture de certains établissements, etc. Je me suis largement impliquée sur ce sujet. Avec Alternative socialiste verte, nous avons organisé un grand débat public que nous voulions orienter vers la fermeture des asiles : il fallait ouvrir les portes et laisser circuler les gens. En Suisse maintenant, les hôpitaux psychiatriques sont assez ouverts, il reste cependant des hospitalisations sous contrainte mais c’est moins souvent et surtout pour des durées moins longues.
S’agiter, creuser, bâtir
Les partis, en recherche de pouvoir et de respectabilité, consacrent désormais leurs efforts à la gestion du probable plutôt qu’au changement de société et les Verts ne sont pas différents. Le plus souvent, ce sont des collectifs hors partis qui occupent l’espace public, pour la défense du droit d’asile, des droits humains, contre le nucléaire… Partout, des gens s’agitent, creusent, bâtissent. Iels fondent des comités, s’organisent, tiennent le coup. Mais sans vision d’ensemble. Plus les groupes sont faibles, plus ils sont motivés et inventifs. Mais plus ils manquent aussi de moyens pour se faire entendre. Les groupuscules, parfois menacés par une forme d’intransigeance, trouvent rapidement leurs limites : sans moyens d’actions d’envergure susceptibles de créer un rapport de force prolongé, il ne faut pas longtemps avant qu’ils disparaissent ou qu’ils acceptent les concessions nécessaires à une intégration dans le système institutionnel. Alors comment faire pour que les choses changent ? Avec ce thème de l’effondrement global qui est très à la mode en ce moment, je me dis qu’on devrait peut-être se concentrer sur le jour d’après l’effondrement. Ce n’est pas vraiment un programme politique populaire mais, blague à part, si les communautés actives sur le terrain se trouvaient en conjonction avec celles et ceux qui en font la traduction en politique, je pense qu’il y aurait une possibilité de changement. Il ne faut pas que les gens se regardent en chiens de faïence, ni en chiens de bataille.
à la longue, iels rentrent dans des logiques de cumul des mandats, iels se coupent de la population… Les parlementaires devraient redevenir militant·e·s. Adhérer à un parti politique donne des perspectives plus globales que d’être seulement dans une association avec un objet précis. Il faudrait aussi que les gens qui sont sur le terrain, dans des actions locales concrètes arrivent à mieux se structurer qu’iels ne le font aujourd’hui et à opérer une jonction avec les autres niveaux de la politique. C’est ce qu’on aurait pu attendre de mouvements comme les Indigné·e·s, Podemos, Nuit Debout, Occupy Wall Street ou les Gilets Jaunes… Ces mouvements créent de l’espoir, parviennent à semer un certain chaos mais ça ne dure qu’un temps… Et ça renaît ailleurs, toujours si peu structuré… Les optimistes pensent que les projets alternatifs pourraient progressivement grignoter la société capitaliste et la faire basculer. Les pessimistes disent que s’extraire du capitalisme lui permet de prospérer sans être dérangé·e… Je n’ai pas de réponse.
[1] Conseil national : chambre basse de l’Assemblée fédérale suisse, renouvelée tous les quatre ans, équivalent de l’Assemblée nationale en France, composée de 200 parlementaires.
[2] Grand Conseil : parlement à l’échelle cantonale, composé de 150 parlementaires élu·e·s pour cinq ans. Sur le canton de Vaud, il y a environ 1 200 élect·rice·s pour un·e parlementaire.
[3] Grève générale de 1918 en Suisse : à l’automne 1918, à l’approche du premier anniversaire de la révolution d’Octobre, et craignant que des manifestations spontanées fassent « passer la Suisse au bolchevisme », le Conseil fédéral (le gouvernement suisse) ordonne l’occupation militaire de Zurich ; le comité d’Olten qui regroupe les forces politiques et syndicales du socialisme suisse, répond alors par une grève générale contre la « dictature des sabres » suivie par 250 000 ouvrièr·e·s et employé·e·s des différents secteurs, tandis que près de 100 000 soldats sont déployés à travers le pays et brisent la grève. Cette grève générale est souvent considérée comme l’événement qui a fait trembler la bourgeoisie suisse.
[4] Care : terme anglais repris comme concept pour englober les notions de soin, de souci, de proximité, d’attention à autrui, afin de visibiliser le travail de care (to take care), c’est-à-dire le fait que des personnes, très majoritairement des femmes, s’occupent des autres, s’en soucient et veillent ainsi au fonctionnement ordinaire du monde dans le cadre domestique et quotidien, et donc le plus souvent tenu pour secondaire, invisible, non-payé.
[5] Mourir Debout, soixante ans d’engagement politique, Anne-Catherine Menétrey, Éditions d’en bas, 2018, 450 p. Avec l’accord de l’autrice, certains passages de cet entretien ont été prolongés en s’appuyant sur cet ouvrage.

On avait des rêves,
on savait où
on voulait aller
Marisa, Italie – Besançon / France
Être anarchiste n’était pas si abominable
Ça ne s’arrêtait jamais
La joie de dire « c’est moi qui décide »
Lutter comme une manière d’être
Au final, elles ont tenu et ils ne sont pas passés. Après ce blocage, la Mairie a refait la route !
il y avait beaucoup d’attentats clairement orchestrés par l’État italien, la CIA et les fascistes. Ils avaient peur que la situation politique ne porte les Rouges au pouvoir, comme ils disaient. Alors, les services secrets italiens et américains avaient mis en place ce qu’on a appelé plus tard la stratégie de la tension. Ça a commencé en 1969 avec la bombe de Piazza Fontana à Milan, suivie de l’arrestation et de la défenestration de l’anarchiste Pinelli. Ils avaient tout de suite pris pour cible les anarchistes. Du jour au lendemain, ta voisine de palier ne te disait plus bonjour et te regardait terrorisée en pensant que tu étais anarchiste. Nous, on a tout de suite compris les manigances de l’État. Mais le Parti communiste, sans doute parce qu’il était déjà fragilisé, bien qu’encore majoritaire, a mis du temps à dénoncer ce qui se passait, toutes ces bombes qui explosaient dans les gares et sur les places, et les anarchistes arrêté·e·s massivement à tort.
Tu t’appelleras comme ça et là,
on va à Venise…
Tout semble bouché et pourtant…

Je leur ai chuchoté « Mais vous savez, je suis anarchiste ! »
Maryvonne, Nantes / France
Il y a beaucoup plus de possibilités
que tu ne crois
Les deux étaient socialistes et avaient adhéré pendant un moment à la SFIO (la Section française de l’internationale ouvrière, qui est devenu le Parti socialiste en 1969). Iels se situaient dans l’aile gauche du parti, mais sans aller aux réunions nationales. Ça ne les intéressait pas, leur militantisme était local. Les deux avaient aussi été membres d’un parti qui n’a duré que quelques mois, avant la guerre et qui s’appelait le PSOP, Parti socialiste ouvrier et paysan. C’était un mélange d’anarchisme, de trotskisme et de socialisme révolutionnaire. Iels ont milité jusqu’en 1939 puis la guerre les a tellement bouleversé·e·s qu’iels ont arrêté. Pendant la guerre, faisant partie d’un réseau, mes parents ont hébergé un réfugié espagnol dans leur maison à Plouray, c’est entre le Finistère et le Morbihan. À ce moment-là, il y avait du monde qui quittait l’Allemagne, des personnes juives en particulier, qui passaient à Plouray et qu’il fallait héberger pendant quelques jours.
J’ai décidé un jour que j’étais anarchiste
C’était la guerre… et on riait beaucoup
Et puis en tant qu’anarchiste dans la FEN, j’ai rejoint le groupe de l’École émancipée, qui était une tendance syndicaliste révolutionnaire de ce syndicat. La FEN était organisée en tendances. À l’École émancipée, il y avait des trotskistes, des anarchistes et des syndicalistes révolutionnaires qui, en général, se rangeaient du côté des anarchistes… et c’était la guerre ! Au sein de la FEN, il fallait lutter contre les réformistes proches du PS, contre la tendance Unité-Action proche du PC. Ça faisait beaucoup de réunions pour mettre au point nos stratégies. Nous nous servions du syndicat pour faire la propagande des idées anarchistes dans un but révolutionnaire. C’est pourquoi, d’ailleurs, il fallait aller aux congrès, même si nous n’y avions pas beaucoup de places parce que nous étions minoritaires. Nous n’y allions pas pour faire du tourisme, il fallait absolument prendre la parole dans les tribunes ! D’ailleurs ma première fois, ça n’a pas été triste… Nous étions deux de l’École émancipée à nous rendre au congrès de la FEN. L’autre était trotskyste, on se répartissait là aussi : s’il y avait deux places il y en avait une pour les trotskystes et l’autre pour les anarchistes… On va donc à deux au congrès et là, il m’abandonne ! C’est mon premier congrès tandis que lui est plus âgé et expérimenté. À un moment, j’entends à la tribune qu’on demande aux gens de donner leur nom et leur sujet d’intervention. J’étais venue au congrès pour intervenir alors je vais m’inscrire, mais j’ignore que le temps de parole est réparti proportionnellement aux mandats de chaque tendance. Je devrais donc avoir un temps de parole très limité. Je devrais préciser quelle tendance je représente… mais je ne dis rien, tout simplement parce que je ne suis pas au courant ! La commission qui distribue le temps de parole croit donc que je suis de la majorité et m’attribue un temps vraiment long ! On m’appelle au micro alors j’y vais, c’est la première fois que je parle dans un micro. Comme je suis petite, il faut qu’ils mettent le micro à ma taille, ils sont gentils avec moi, heureusement, parce que je suis quand même intimidée. Quand je prends la parole, c’est pour dire qu’il faut voter contre eux. Alors dame ! Évidemment, je vois leurs têtes, mais j’ai plein de temps pour les démonter !… Après coup, j’ai su que les camarades de l’École émancipée des autres départements qui ne me connaissaient pas, puisque c’était la première fois que je venais, avaient tout de suite compris que j’étais de leur groupe. Ensuite, iels sont venu·e·s me trouver et m’ont prise en main. Les autres anars et les syndicalistes révolutionnaires étaient là, et tout le monde a protesté parce que le copain trotskyste ne m’avait pas dit comment ça fonctionnait : normalement, il y avait des réunions entre les différents groupes de l’École émancipée avant les prises de parole, pour préparer les interventions mais ça, il ne me l’avait pas dit non plus. C’est vous dire comment ça fonctionnait, c’était la guerre, tous les coups étaient permis…
On s’engage lorsque l’on prend
des risques
J’avais une grande liberté
trouvaient ma vie déjà très différente de la leur.
Par exemple, j’étais célibataire, ce qui me convenait parfaitement. Ça, même au niveau des copains du groupe anar, ce n’était pas très bien vu. Ils trouvaient quand même que c’était formidable d’avoir une famille… et puis coucher avec Pierre, Paul et Jacques comme ça, ça les dérangeait un peu. Parce qu’être célibataire, ça ne veut pas dire être seule ! Leur attitude m’avait choquée mais je n’avais pas osé leur dire, parce que c’était mes débuts… Ils parlaient d’une copine qu’ils avaient réussi à virer d’ailleurs. Ils disaient « de toute façon, elle a couché avec tous les gens du groupe ». J’avais trouvé ça monstrueux qu’on ose lui reprocher ça ! En plus les gens du groupe, c’était eux ! Qu’est-ce que ça pouvait leur faire ? Ils acceptaient un peu quand même, ils étaient tolérants… mais tu parles, pour des anarchistes… Une fois, on était à Bordeaux pour une réunion très importante. Là-bas, je fais la connaissance d’un jeune bordelais. On ne restait que deux jours, alors quand les autres repartent, je dis « non, moi je reste ». Ils étaient sidérés ! Même s’ils ne m’ont pas fait de réflexions particulières… Et je suis restée quelques jours. Mais on ne parlait pas beaucoup de trucs comme ça. Pour eux, la lutte, c’était comme le boulot, on n’était pas là pour copiner, on mangeait ensemble des fois, les un·e·s chez les autres, mais pas beaucoup plus. Et puis on était à la FA mais sans trop nous occuper des autres groupes de la FA, ça ne nous intéressait guère. On allait au congrès à deux ou trois, quand ce n’était pas très loin et c’est tout. On lisait vaguement le bulletin intérieur qu’on recevait et c’est tout. J’ai noué des relations plus importantes avec les membres de l’École émancipée, et notamment celles et ceux de l’Isère,
que je rencontrais pendant les Collèges, qui étaient les réunions nationales de l’École émancipée à Paris. Et puis ma maison était ouverte ! En 68 les élèves de l’École normale avaient le droit de sortir un peu et passaient chez moi. Quand je n’étais pas là, iels savaient où était la clef. Je profitais surtout beaucoup de mes vacances, plus peut-être que les gens qui étaient en famille avec des enfants. J’avais une grande liberté et c’était justement ça qui me plaisait. Le fait d’être célibataire, c’était ça l’essentiel.
En mai 68, les copains m’ont déçue comme je les ai déçus
L’effondrement du mouvement syndical avait déjà commencé
Il y avait une manif et j’y suis allée !
[1] L’anarcho-syndicalisme est un mode d’expression de l’anarchisme. C’est une stratégie qui parie sur l’utilisation du syndicalisme pour favoriser la révolution. À la différence des autres syndicalistes révolutionnaires, les anarcho-syndicalistes ne veulent pas d’une dictature du prolétariat mais prônent l’autogestion, l’anti-autoritarisme, le fédéralisme et la démocratie directe. Iels veulent une organisation horizontale.
[2] ZAD : Zone à défendre contre le projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, à coté de Nantes. La zone occupée par des opposant·e·s au projet a subi plusieurs vagues d’expulsions dont la plus grosse et la plus connue est celle de l’automne 2012, ce qui avait contribué à largement médiatiser cette lutte.
L'engagement dure longtemps
Comment « changer la vie » vraiment ?
Dans les mouvements, luttes, mobilisations, engagements du présent, on ne peut qu’être frappée par les connaissances des jeunes générations féministes, comme si le temps s’était sédimenté, en quelque sorte condensé. Elles savent beaucoup de ce qui s’est passé avant elles ; c’est comme si elles avaient incorporé le travail, longuement mené, les théories, les concepts et plus encore les combats. En même temps bien sûr, elles s’élancent, elles inventent et avancent : elles font du neuf. Mais la conscience d’une coexistence des temps est là. Qu’on accepte le terme de « vagues » à propos du féminisme, ou pas, on sait bien qu’il y a une déjà longue histoire derrière soi. Quelques décennies auparavant, c’était différent. 1970, date de fondation du MLF notamment, pouvait donner l’impression d’être une « année zéro » pour la libération des femmes, évoquée en tout cas comme telle dans la revue Partisans. Il fallait se plonger dans ce passé qu’on ne connaissait pas, aller à la recherche des oubliées, à partir de presque rien tant cette histoire était demeurée jusqu’alors sans objet, parce que peu s’y intéressaient. On se rappelle l’hymne du MLF : « Nous qui n’avons pas d’histoire… » Les femmes avaient une histoire bien sûr, mais elle n’avait pas été faite ; on ne la trouvait pas dans les ouvrages savants – qu’écrivaient des hommes. Elle avait été seulement cantonnée à la reine et à la sainte, à l’espionne et à la courtisane. Celles que retenaient les livres et les chronologies s’égrenaient de Cléopâtre et Jeanne d’Arc à Mata Hari. Le récit en était étriqué, rabougri comme un arbre dont on n’a pas pris soin. Il fallait tout découvrir, arpenter les luttes et les faire sortir de l’oubli. Au fond, ce recueil est un prolongement de ce désir et il en est la confirmation.
Il est temps, de nouveau, parce que la période est intense en termes d’engagements et qu’on a besoin de savoir où ils ont pris naissance. De ce point de vue, les vagues ne se succèdent pas comme si l’une chassait l’autre. Elles s’enroulent plutôt l’une à l’autre.
Raison à majuscule. Depuis quelques années, des travaux de sciences sociales ont récusé ce clivage trop pesant et en partie absurde, très occidental d’ailleurs par son tranchant : dans tant et tant de cultures, on ne sépare pas les émotions et la raison. Les émotions sont une forme d’intelligence sensible et il n’y a pas beaucoup d’engagements qui ne soient nés, liés et nourris par des sentiments. « On reproche souvent aux femmes d’être trop dans l’émotion, relève Anne-Catherine. À mon sens, ce n’est pas un défaut en politique. Il faut garder sa capacité à s’indigner ! » Absolument… Et c’est aussi une belle occasion de dégenrer les émotions.